« Je ne lis jamais un livre dont je dois écrire la critique ;
on se laisse tellement influencer. »
Oscar Wilde
« Noli me ligere », « ne me lis pas ». Ce sont quelques mots que le livre adresserait à son auteur selon le critique littéraire Maurice Blanchot. S’il veut devenir une œuvre, le livre doit irrémédiablement se détacher de l’écrivain pour partir à la rencontre de ses lecteurs. Au travers de la lecture, donc ? Pierre Bayard, dans son ouvrage éminemment provocateur, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus, nous démontre que non, pas forcément, pas toujours, peut-être même jamais. Et si « il était tout à fait possible d’avoir un échange passionnant à propos d’un livre que l’on a pas lu, y compris, et peut-être surtout, avec quelqu’un qui ne l’a pas lu non plus » ? D’une manière très ludique, Pierre Bayard remet en branle toutes nos certitudes sur l’acte de lire, sur notre approche face aux œuvres et sur notre aptitude à en parler. Le lecteur convaincu est amené à s’interroger sur la sempiternelle question : à quoi bon lire ?
Les premères lignes intriguent par leur portée scandaleuse. Pierre Bayard, critique littéraire et professeur de littérature à l’Université, affirme ne pas aimer lire et ne pas s’adonner à cette activité bien trop chronophage. Il prône les bienfaits de la non-lecture et place son lecteur (quel paradoxe!) dans une situation incommodante : lecteurs, vous qui affirmez porter un intérêt à la littérature, comment supportez-vous de ne vous concentrez que sur une œuvre seule, et de prendre le risque inévitable de négliger l’ensemble des autres ? Si le bibliothécaire de Robert Musil (L’Homme sans qualité) est dans la capacité de connaître tous ses livres, c’est parce qu’il s’évertue à ne se constituer qu’une « vue d’ensemble » au travers des catalogues. Un savant en littérature se présente alors bien plus comme un navigateur, habile dans son espace, que comme celui qui ne cesse de plonger et qui finalement n’aperçoit plus grand chose. Paul Valéry, écrivain et fervent prôneur de la non-lecture, est capable, en 1923, d’écrire un vibrant hommage à Proust et à ses écrits dans la Nouvelle Revue Française, sans avoir lu aucune de ses œuvres. Il ne s’en cache pas, il le revendique, il suffit de feuilleter Proust pour saisir l’essence de son écriture, il suffit de lire quelques articles pour en connaître les histoires.
 Pierre Bayard, de manière cynique, met implicitement au défi son lecteur de lui citer un seul livre qu’il ait jamais lu. Qui peut prétendre avoir déjà lu un livre, puisqu’ « alors même que je suis en train de lire , je commence à oublier ce que j’ai lu » ? « Ce processus est inéluctable, il se prolonge jusqu’au moment où tout se passe comme si je n’avais pas lu le livre et où je rejoins le non-lecteur que j’aurais pu rester si j’avais été mieux avisé ». Il est difficile, peut-être impossible, de restituer l’histoire de notre premier livre. Bien plus que cela, on pourrait s’évertuer à le lire une seconde fois, pour autant, les mots n’auraient pas la même saveur ni la même portée. La signification et la valeur que l’on attribue à un texte est aussi mobile et éclectique que nous le sommes, que le sont les sociétés au regard de l’histoire. Ainsi, si tel auteur ou tel genre ont autrefois été décriés (Rousseau pour les Confessions par exemple), on en souligne aujourd’hui le potentiel, ou inversement (L’Astrée d’Honoré d’Urfé est bien loin de connaître le succès de ses jours passés) parce que notre rapport aux œuvres change perpétuellement. Lorsque l’on parle d’un livre, on parle de soi, de la relation qu’on entretien avec lui. L’imaginaire interprète sans cesse, si bien que l’on se crée notre propre « livre intérieur », qui inhibe, déjoue et enraye toute discussion possible portant sur un ouvrage, notre culture personnelle faisant barrière avec le livre physique et avec un potentiel autre lecteur. Un lecteur ne lit pas une œuvre, il se lit lui même, il ne parle pas d’un livre, il parle de lui. Pierre Bayard tente de nous convaincre qu’il est inutile de perdre son temps, puisqu’on ne parviendra jamais à accéder à l’œuvre. Lorsque la tribu des Tiv d’Afrique de l’Ouest parle d’Hamlet de Shakespeare, elle ne parle pas de la pièce, mais de sa propre culture, notamment lorsqu’elle s’interroge sur la présence des fantômes qui leur sont étrangers, sur certains liens familiaux qui lui semble d’une importance primordiale, mais qui ne revêtent aucune importance pour les sociétés occidentales. Les interprétations s’affrontent. Alors à quoi bon lire s’il s’agit d’une activité stérile qui ne participerait qu’au développement d’un certain ego-centrisme ?
Pierre Bayard, de manière cynique, met implicitement au défi son lecteur de lui citer un seul livre qu’il ait jamais lu. Qui peut prétendre avoir déjà lu un livre, puisqu’ « alors même que je suis en train de lire , je commence à oublier ce que j’ai lu » ? « Ce processus est inéluctable, il se prolonge jusqu’au moment où tout se passe comme si je n’avais pas lu le livre et où je rejoins le non-lecteur que j’aurais pu rester si j’avais été mieux avisé ». Il est difficile, peut-être impossible, de restituer l’histoire de notre premier livre. Bien plus que cela, on pourrait s’évertuer à le lire une seconde fois, pour autant, les mots n’auraient pas la même saveur ni la même portée. La signification et la valeur que l’on attribue à un texte est aussi mobile et éclectique que nous le sommes, que le sont les sociétés au regard de l’histoire. Ainsi, si tel auteur ou tel genre ont autrefois été décriés (Rousseau pour les Confessions par exemple), on en souligne aujourd’hui le potentiel, ou inversement (L’Astrée d’Honoré d’Urfé est bien loin de connaître le succès de ses jours passés) parce que notre rapport aux œuvres change perpétuellement. Lorsque l’on parle d’un livre, on parle de soi, de la relation qu’on entretien avec lui. L’imaginaire interprète sans cesse, si bien que l’on se crée notre propre « livre intérieur », qui inhibe, déjoue et enraye toute discussion possible portant sur un ouvrage, notre culture personnelle faisant barrière avec le livre physique et avec un potentiel autre lecteur. Un lecteur ne lit pas une œuvre, il se lit lui même, il ne parle pas d’un livre, il parle de lui. Pierre Bayard tente de nous convaincre qu’il est inutile de perdre son temps, puisqu’on ne parviendra jamais à accéder à l’œuvre. Lorsque la tribu des Tiv d’Afrique de l’Ouest parle d’Hamlet de Shakespeare, elle ne parle pas de la pièce, mais de sa propre culture, notamment lorsqu’elle s’interroge sur la présence des fantômes qui leur sont étrangers, sur certains liens familiaux qui lui semble d’une importance primordiale, mais qui ne revêtent aucune importance pour les sociétés occidentales. Les interprétations s’affrontent. Alors à quoi bon lire s’il s’agit d’une activité stérile qui ne participerait qu’au développement d’un certain ego-centrisme ?
 Les mots de Pierre Bayard résonnent, dérangent, et si l’on sourit souvent, on s’interroge surtout, on se remet en cause, parfois même on pourrait se résigner. Les démonstrations semblent sans faille, et si l’idée même d’abandonner notre lecture s’immisce dans notre esprit, les mots pourtant défilent sous nos yeux, on manque d’envie, on manque de courage, on ne peut pas vraiment expliquer ce qui nous retient là… Pierre Bayard nous invite enfin à repenser les objectifs que l’on attribue et impose à la lecture. Oscar Wilde affirmait qu’il suffit de six minutes montre en main pour lire un ouvrage, ce qui semblait suffisant pour saisir l’essence d’une œuvre, et assez pour ne pas se perdre dans le livre. Parler d’un livre que l’on a fait qu’effleurer, avec lequel on a gardé des distances, c’est penser autrement, se découvrir, se plonger dans les tréfonds de son imagination. C’est créer quelque chose de nouveau. Il ne s’agit sûrement pas de ne plus lire, mais d’apprendre à s’approprier pleinement une œuvre. Le lecteur, « se libérant enfin du poids de la paroles des autres, trouve en soi la force d’inventer son propre texte et de devenir écrivain ». En prenant ses distances, il s’adonne à la rédaction d’un texte, d’un livre, d’une critique, et pourquoi pas d’un article. Le lecteur saisit alors sa plume, et couche sur du papier les secrets de sa bibliothèque intérieure.
Les mots de Pierre Bayard résonnent, dérangent, et si l’on sourit souvent, on s’interroge surtout, on se remet en cause, parfois même on pourrait se résigner. Les démonstrations semblent sans faille, et si l’idée même d’abandonner notre lecture s’immisce dans notre esprit, les mots pourtant défilent sous nos yeux, on manque d’envie, on manque de courage, on ne peut pas vraiment expliquer ce qui nous retient là… Pierre Bayard nous invite enfin à repenser les objectifs que l’on attribue et impose à la lecture. Oscar Wilde affirmait qu’il suffit de six minutes montre en main pour lire un ouvrage, ce qui semblait suffisant pour saisir l’essence d’une œuvre, et assez pour ne pas se perdre dans le livre. Parler d’un livre que l’on a fait qu’effleurer, avec lequel on a gardé des distances, c’est penser autrement, se découvrir, se plonger dans les tréfonds de son imagination. C’est créer quelque chose de nouveau. Il ne s’agit sûrement pas de ne plus lire, mais d’apprendre à s’approprier pleinement une œuvre. Le lecteur, « se libérant enfin du poids de la paroles des autres, trouve en soi la force d’inventer son propre texte et de devenir écrivain ». En prenant ses distances, il s’adonne à la rédaction d’un texte, d’un livre, d’une critique, et pourquoi pas d’un article. Le lecteur saisit alors sa plume, et couche sur du papier les secrets de sa bibliothèque intérieure.
Pauline Fricot
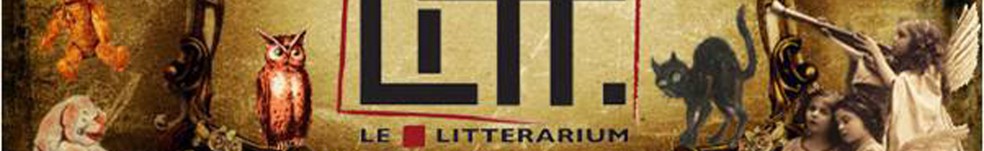


 Mais de quoi est-il question lorsque l’on prétend ne pas avoir lu un livre ? Comment définir la non-lecture ? L’auteur fait la tentative de montrer les relations qui sous-tendent les deux pratiques de lecture et de non-lecture. On peut feuilleter, survoler, lire vautré sur son lit en écoutant de la musique ou bien assis à un bureau dans le silence. De plus, entre lire un livre avec attention et parler d’un livre qu’on n’a jamais eu entre les mains, il existe une infinité de modes de lecture. N’est-il pas vrai que certains livres que nous n’avons jamais lus exercent des effets sensibles sur nous, ne serait-ce que par les échos qui nous en parviennent ?
Mais de quoi est-il question lorsque l’on prétend ne pas avoir lu un livre ? Comment définir la non-lecture ? L’auteur fait la tentative de montrer les relations qui sous-tendent les deux pratiques de lecture et de non-lecture. On peut feuilleter, survoler, lire vautré sur son lit en écoutant de la musique ou bien assis à un bureau dans le silence. De plus, entre lire un livre avec attention et parler d’un livre qu’on n’a jamais eu entre les mains, il existe une infinité de modes de lecture. N’est-il pas vrai que certains livres que nous n’avons jamais lus exercent des effets sensibles sur nous, ne serait-ce que par les échos qui nous en parviennent ?