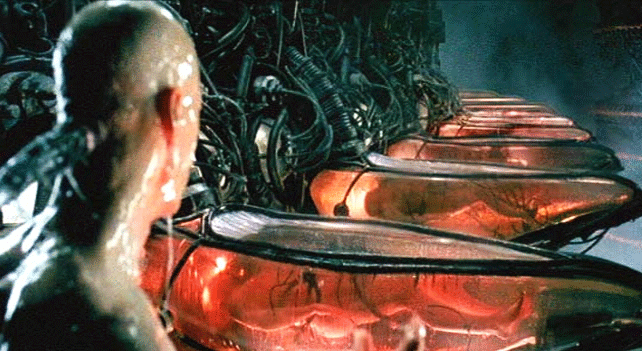S’il est admis que le progrès technoscientifique est généralement bénéfique à l’humanité, il faut cependant considérer qu’il peut aisément se retourner contre nous avec force et violence. L’innovation d’un côté et la sécurité de l’autre se livrent une course parallèle démesurée. La seconde essayant de rattraper la première par le biais de la prévention (dispositifs de contrôle techniques, déontologiques, législatifs, réglementaires, etc.) pour éviter de se satisfaire d’une simple réparation de dommages.
Amor fati machinique
Une discipline universitaire s’est même créée pour prévenir le risque technique : la « cynindique », la « science du danger ». Mais deux limites viennent se heurter à ce projet : premièrement, les connaissances qui nous permettent d’innover vont plus vite que celles permettant de contrôler ces innovations, ce que le neuro-scientifique Graham Collingridge résume par le paradoxe suivant : « plus l’innovation est rapide, plus il y a potentialisation du risque technique » ; deuxièmement, le « facteur humain » est totalement imprévisible et l’homme peut désirer la violence technique. Pour appréhender cette jouissance destructrice de la technique dans l’esprit humain ce n’est pas tant vers la cynindique qu’il faut se tourner mais du côté de l’art, et notamment de la Science-Fiction.
 La plupart des films de SF (de Brazil à Matrix) interprètent la violence technicienne en termes de volonté mauvaise, exercée de l’extérieur par une minorité (thème récurrent des contre-utopies). D’autres, plus rares, suggèrent que la violence du monde technique est interne à chaque être et directement liée à nos désirs inconscients. Ainsi, le fléau des accidents de la route (30 millions de morts depuis un siècle et la probable troisième cause de décès en 2020) est considéré comme un moindre mal pour satisfaire notre besoin de vitesse. Phénomène qu’illustre métaphoriquement le film Screamers de Peter Weller, où les humains sont traqués par des machines tueuses pouvant se multiplier et se perfectionner seules. Ce ne sont plus les hommes qui produisent les objets techniques mais le système technique lui-même après avoir dévoré l’être humain. Les machines sont également objets de désir : nous désirons les machines, quitte à y succomber, mais nous les aimons aussi parce qu’elles sont mortelles et déshumanisantes. David Cronenberg est un des meilleurs explorateurs des « racines existentielles de la violence technique » selon le philosophe Daniel Cérézuelle.
La plupart des films de SF (de Brazil à Matrix) interprètent la violence technicienne en termes de volonté mauvaise, exercée de l’extérieur par une minorité (thème récurrent des contre-utopies). D’autres, plus rares, suggèrent que la violence du monde technique est interne à chaque être et directement liée à nos désirs inconscients. Ainsi, le fléau des accidents de la route (30 millions de morts depuis un siècle et la probable troisième cause de décès en 2020) est considéré comme un moindre mal pour satisfaire notre besoin de vitesse. Phénomène qu’illustre métaphoriquement le film Screamers de Peter Weller, où les humains sont traqués par des machines tueuses pouvant se multiplier et se perfectionner seules. Ce ne sont plus les hommes qui produisent les objets techniques mais le système technique lui-même après avoir dévoré l’être humain. Les machines sont également objets de désir : nous désirons les machines, quitte à y succomber, mais nous les aimons aussi parce qu’elles sont mortelles et déshumanisantes. David Cronenberg est un des meilleurs explorateurs des « racines existentielles de la violence technique » selon le philosophe Daniel Cérézuelle.
La liberté par l’autodestruction
 Crash dépeint un univers fictif réduit à sa seule dimension technique. La société est absente, la nature est absente, la ville habitée est absente. Seuls demeurent des individus isolés errant sur des routes, avec pour unique perspective le sexe et la machine, en l’occurrence la voiture. Dans un monde sans vie, l’émotion est inexistante. Ne satisfaisant plus leurs désirs par le sexe, ils se tournent vers la violence automobile, ultime recours pour aller au-delà de leurs limites corporelles dans un dépassement existentiel définitif. Grâce à la « belle catastrophe » ils sont à la fois délivrés de leur prison charnelle, et accèdent à l’éternité par l’existence immatérielle de la diffusion ultra médiatique de l’accident.
Crash dépeint un univers fictif réduit à sa seule dimension technique. La société est absente, la nature est absente, la ville habitée est absente. Seuls demeurent des individus isolés errant sur des routes, avec pour unique perspective le sexe et la machine, en l’occurrence la voiture. Dans un monde sans vie, l’émotion est inexistante. Ne satisfaisant plus leurs désirs par le sexe, ils se tournent vers la violence automobile, ultime recours pour aller au-delà de leurs limites corporelles dans un dépassement existentiel définitif. Grâce à la « belle catastrophe » ils sont à la fois délivrés de leur prison charnelle, et accèdent à l’éternité par l’existence immatérielle de la diffusion ultra médiatique de l’accident.
Dans La Mouche, Cronenberg met en scène un chercheur ayant découvert la téléportation en mettant « la chair en équations ». Mais suite à une erreur, son génome fusionne avec celui d’une mouche, et peu à peu se métamorphose. Dans son exaltation de dépasser ses limites humaines, il en perd toute humanité, physique comme morale, et finit par user de la force pour poursuive son rêve technoscientifique. Le désir d’une liberté désincarnée serait un « instinct secret » poussant les être humains à la violence technicienne.
 eXistenZ enfin nous plonge dans le monde de la réalité virtuelle totale. Coupés du réel, les participants à ce « grand jeu » ne ressentent aucune angoisse, aucune contrainte physique, aucune identité fixe, aucune attache géographique, aucune soumission temporelle. En somme aucune barrière à la liberté absolue. Ce qui entraîne la suppression du souci de l’autre, réduit à une apparence caricaturale pouvant être éliminée à tout instant ; la suppression des scrupules, car les actes n’ont pas de conséquences définitives dans un univers perpétuellement recomposé ; la suppression de l’autonomie et de la raison, le joueur devenant dépendant de sa logique ludique. Advient le règne des pulsions les plus barbares comme la rivalité et la violence.
eXistenZ enfin nous plonge dans le monde de la réalité virtuelle totale. Coupés du réel, les participants à ce « grand jeu » ne ressentent aucune angoisse, aucune contrainte physique, aucune identité fixe, aucune attache géographique, aucune soumission temporelle. En somme aucune barrière à la liberté absolue. Ce qui entraîne la suppression du souci de l’autre, réduit à une apparence caricaturale pouvant être éliminée à tout instant ; la suppression des scrupules, car les actes n’ont pas de conséquences définitives dans un univers perpétuellement recomposé ; la suppression de l’autonomie et de la raison, le joueur devenant dépendant de sa logique ludique. Advient le règne des pulsions les plus barbares comme la rivalité et la violence.
La fascination de la violence émanant des techniques automobiles et de celles de l’imagerie explique la jouissance d’abolir la réalité, le temps, et la responsabilité de nos actes. Ce désir secret à la liberté totale (dévoilé par les arts en général et la science-fiction en particulier) peut donc s’engouffrer dans ce que le philosophe Jean Brun appelait « la puissance onturgique de la technique, créatrice de nouvelles modalités d’être ». Au risque de s’abîmer dans des violences autodestructrices sans retours.
Sylvain Métafiot